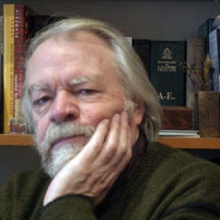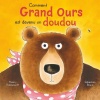Les mots interdits
Le 18 décembre 2017
«Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde». Albert Camus
Non, nous ne sommes pas le 1er avril.
Non, cela ne se passe pas dans une dictature lointaine.
Non, ce n’est pas un article du Gorafi.
Cela se passe aux États-Unis. De quoi s’agit-il ?
L’inénarrable Donald Trump a pressé son administration d’informer la principale agence de santé publique, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), que dorénavant, certains mots ou expressions seront interdits dans la communication avec ses services (notamment dans la confection des budgets).
Sont concernés : droit, fœtus, transgenres, diversité, vulnérable, fondé sur la science, fondé sur les faits et prestations sociales.
Le président s’était déjà fait remarquer dans cette manie de faire disparaitre des mots du discours officiel en faisant retirer la page consacrée au changement climatique du site internet de l’agence de protection de l’environnement (EPA). Toute trace de cette question vitale a été retirée du site de la Maison-Blanche.
Ainsi donc, il est possible de nier certaines réalités en supprimant les mots dont elles sont affublées ? La naïveté du président et de son administration n’a décidément aucune limite… Le mot « stupide » n’est toujours pas interdit, heureusement !
Les mots interdits ou pour lesquels les députés canadiens sont invités à changer la formulation de leurs communications au parlement sont nombreux (328 en fait !). En voici quelques-uns : visage à deux faces, débile, servilité, couillonner, les petits amis du régime, poltron, pelleter du fumier, sépulcre blanchi, tartuferie, torchon, tripotage, hypocrite, stratagème...
Et depuis 2015, âneries, maquiller, harcèlement, Shylock (un personnage usurier dans Shakespeare) ont allongé la liste !
Donc Trump n’a pas le monopole d’avoir édicté une liste semblable. Poutine l’avait fait en 2014 en interdisant une série d’injures dans les arts et les médias, avec amendes à la clé, de 70 à 1400 $. Les gros mots dans les livres devaient aussi être signalés par un avertissement en couverture.
On se rend bien compte que dans toutes ces démarches, l’idéologie est manifestement présente.
Je ne jetterai bien sûr pas la pierre aux enseignants qui cherchent à éradiquer du discours de leurs élèves les mots truc, machin, chose, chouette et leurs homologues pour les remplacer par le mot juste ou une phrase (et pourquoi pas plusieurs) afin d’exprimer leur pensée ou leurs émotions avec plus de finesse...